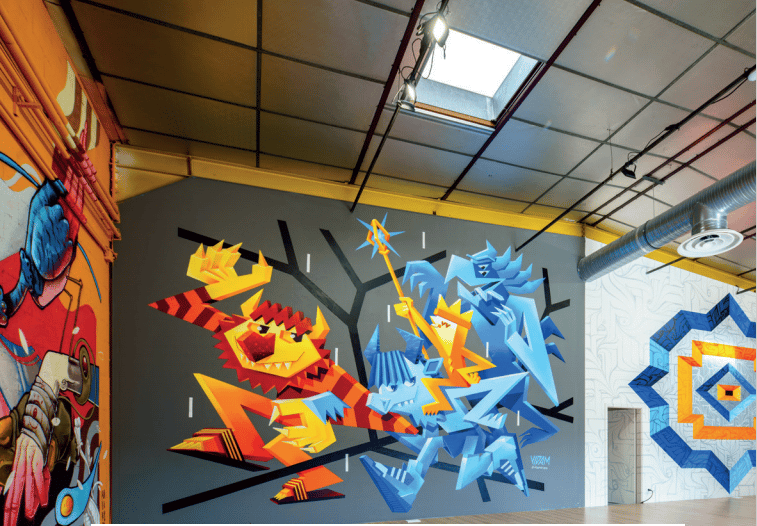Le président de la toute jeune Fédération de l’Art Urbain nous explique les enjeux auxquels les artistes qui s’expriment dans l’espace public sont confrontés et la nécessité de passer à une parole plus unifiée.
Par Christian Charreyre
Jean Faucheur est l’un des grands défenseurs de l’Art Urbain. Ce pionnier est notamment l’un des fondateurs de l’association Le M.U.R Oberkampf. Avec la création de la Fédération de l’Art Urbain, lui et des personnes du milieu associatif ont choisi d’entrer en discussion avec le Ministère de la culture.
 Comment est née cette fédération ?
Comment est née cette fédération ?
Elle est toute neuve, puisqu’elle a vu le jour il y a un an mais n’est active que depuis le mois de juillet. En avril de l’année dernière, avec Chaima Ben Haj Ali, je me suis occupé d’une exposition qui s’appelait « À l’échelle de la ville », organisée par le ministère de la culture, autour des façades du ministère à Paris. Dans ce cadre, nous avons proposé à l’artiste Module de Zeer un projet sur les colonnes en face de l’oeuvre de Daniel Buren, dans les les jardins du Palais-Royal. Sa proposition était très respectueuse du travail de Buren. L’exposition s’est très bien passée, mais trois semaines plus tard, Daniel Buren a envoyé une lettre un peu comminatoire au ministère, demandant le décrochage de l’oeuvre. Ce que le ministère a voulu faire, sans l’avis de Module de Zeer, ce qui est contraire à la loi. On a là l’opposition de deux droits, celui d’un artiste internationalement connu et d’un autre qui l’est un peu moins. Cela a créé un peu de remous dans le microcosme de l’Art Urbain et nous avons choisi d’entrer en discussion avec le ministère.
Ces discussions ont-elles conduit à la création de la fédération ?
Lors de ces réunions, deux décisions ont été prises. D’une part, commander une étude sur l’état de l’Art Urbain en France, pour que le ministère puisse avoir quelques éléments concrets de ce qu’est ce milieu ; d’autre part, créer une fédération, le ministère de la culture estimant qu’il serait intéressant d’avoir un interlocuteur, capable de porter des recommandations et peut-être même parfois des récriminations. Elle a été créée très vite avec, au départ, cinq personnes du milieu associatif : Gautier Jourdain, Christian Omodeo (Le Grand Jeu) Robert Jeudy (Le M.U.R), Élise Herszkowicz (Art Azoï) et David Demougeot (Bien Public). Nous n’étions évidemment pas représentatifs. Mais l’idée était de fonder quelque chose tout de suite. Nous allons avoir notre première assemblée générale le 25 octobre, précédée d’une journée de réflexions et de tables rondes sur les objectifs et la politique de la Fédération.
 Il y a toujours eu un dialogue entre les associations et les pouvoirs publics…
Il y a toujours eu un dialogue entre les associations et les pouvoirs publics…
Les associations prennent de plus en plus d’importance aujourd’hui, pas tellement parce qu’elles doivent se faire les interlocutrices entre les pouvoirs publics et les artistes, ce qui était le cas au début des années 2000 quand les choses étaient un peu compliquées, mais parce que les projets dans l’espace public se développent énormément. Les problématiques de vandalisme sont, certes, toujours présentes mais moins sur le devant de la scène. Ce qui est intéressant pour les collectivités, c’est de travailler avec des artistes. Le mot éclaire le paysage, même si beaucoup d’artistes urbains ont commencé en marge de la légalité. Longtemps, la seule perception de l’Art Urbain a été une dégradation du bien public, mais les choses changent…
Est-ce que cela signifie que l’Art Urbain s’assagit ?
Quand on parle de l’Art Urbain, on évoque de beaucoup de choses différentes. Mais pour moi, il y a deux grands courants. D’une part, le graffiti new-yorkais, qui s’est développé comme un mouvement universel sur toute la planète ; d’autre part, dans les années 1980, des mouvements dont l’expression est l’espace urbain et qui n’est pas couplé au graffiti. Ces deux mouvements se croisent et se mélangent parfois. Mais le graffiti reste une pratique avec ses codes, où le vandalisme est l’une des pierres angulaires, parce que ce qui est important, c’est l’adrénaline. Quand on y a goûté, c’est difficile de s’en passer. Je prends souvent l’image du train à vapeur. La locomotive, c’est le graffiti. Et plus on s’éloigne de la locomotive, plus on va vers les premières classes. Le muralisme aujourd’hui rentre dans le wagon de queue, et dans un train, on peut passer d’un wagon à l’autre. Mais enlevez la locomotive et le train s’arrête !
La Fédération va-t-elle représenter tous ces courants ?
Notre objet : « La défense et la promotion des pratiques artistiques dans l’espace public ». Il ne s’agit pas de dire qu’il y en a qui sont bien et d’autres qui le sont moins. C’est compliqué pour une Fédération de conseiller de réaliser quelque chose d’illégal. D’un autre côté, on ne peut pas nier qu’il y ait un intérêt pour tout ce qui s’est fait dans la rue de manière illégale depuis une quarantaine d’années maintenant.
 De plus en plus d’artistes urbains développent la pratique en atelier. Comment allez-vous aborder ce sujet ?
De plus en plus d’artistes urbains développent la pratique en atelier. Comment allez-vous aborder ce sujet ?
En fait, le sujet serait plutôt comment ces artistes se rattachent au marché de l’art. La vraie question : comment présenter des oeuvres qui sont créées pour être dans l’espace urbain ? Qu’est-ce qu’on va montrer ? Très tôt à New York, dès le milieu des années 1970, les gens issus du graffiti ont réalisé des oeuvres sur toile. Ce n’est pas en opposition, c’est juste une autre forme de travail. Mais la problématique du marché nous intéresse dans la perspective d’une professionnalisation des artistes urbains. Le jeune tagueur de 16 ou 17 ans n’en a pas grand chose à faire, mais il y a d’autres artistes qui commencent à avancer dans la vie et qui se posent des questions. Ce sont des sujets sur lesquels nous allons travailler dans les mois et les années qui viennent.
Qu’est-ce qui vous a amené à vous impliquer dans ces sujets pas forcément enthousiasmants ?
Je vous confirme que ce n’est pas très sexy. Mais ce milieu m’a toujours intéressé. Dans les années 1980, j’ai eu une idée de ce qu’était le travail en collectif avec des artistes. Ce qui n’a pas forcément été une sinécure à l’époque. Au début des années 2000, avec la création de l’association Le M.U.R., j’ai été amené à m’intéresser à de jeunes artistes en herbe et j’ai toujours trouvé un peu problématique que les autorités soient dans un rapport un peu violent avec eux. La reconnaissance artistique de ce mouvement s’apparente à une mission. J’ai toujours été un peu abasourdi de voir comment les institutions et le milieu artistique étaient souvent dédaigneux avec nous, alors que du collectif des Frères Ripoulin sont quand même sortis des gens comme Claude Closky ou Pierre Huygue. Je le disais à l’époque : « Regardez ce qui se passe dans la rue, demain ils seront dans les musées ».
[button color= »black » size= »normal » alignment= »none » rel= »follow » openin= »samewindow » url= »https://phoenix-publications.com/produit/urban-arts-magazine-2/ »]Version numérique[/button]