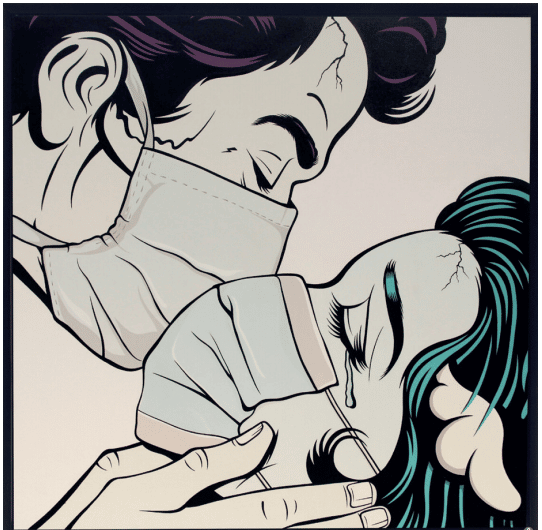Torrick Ablack est l’un des précurseurs du graffiti US dans les années 1980. Exposé très jeune, il a été l’un des premiers à faire entrer cet art dans les institutions, s’imposant
comme un artiste contemporain majeur.
Instagram : @torricka_aka_toxic




Incroyable parcours que celui de Torrick Ablack. Gamin du South Bronx à New York, il commence à peindre les murs et les trains de New York avec ses amis Kool Koor et A-One, membres comme lui du crew T.M.K (Tag Master Killers). Repéré par Stefan Eins de la mythique Fashon Moda Gallery puis par le grand collectionneur Sidney Janis, il impose son style artistique, se lie d’amitié avec Rammellzze et Jean Michel Basquiat – ensemble, ils fondent le crew des Hollywood Africans – et fréquentent les artistes d’East Village, notamment Andy Wahrol. Depuis sa participation en 1984 à la première exposition collective consacrée au graffiti dans un grand musée européen à Bologne, en Italie, Toxic n’a eu de cesse d’imposer son approche artistique foisonnante où le lettrage old school évolue vers l’abstrait, brisant les codes et cassant les murs qui séparent artificiellement l’art urbain de l’art contemporain.
Comment as-tu été confronté à l’art ?
L’art, c’est ce que tu trouves beau, ce qui provoque des émotions. Les premières choses que j’ai trouvées belles, ce sont des dessins de mon grand frère et de ses amis : des avions, des voitures, des vêtements… Ensuite, dans la rue, j’ai découvert les lettrages des gangs. Les premiers graffeurs venaient beaucoup dans mon quartier du South Bronx.
Comment es-tu passé de la rue aux galeries ?
Lorsqu’A-One et moi avons été exposés par Stefan Eins à la galerie Fashion Moda du Bronx, nous avions seulement 14 ans. Puis j’ai signé en exclusivité avec Sidney Janis, le « gardien du temple » du monde de l’art, à 17 ans. À l’époque, il ne signait aucune exclusivité mais je ne le savais pas. Sydney m’a offert la possibilité de créer, en me donnant de l’argent pour payer le loyer notamment. J’avais confiance en lui autant qu’il avait confiance en moi ! D’ailleurs, jusqu’à mes 27 ans, je n’ai exposé qu’avec lui.
Que t’a apporté Jean-Michel Basquiat ?
Waouh ! Basquiat, Wharol et les artistes d’East Village m’ont respecté et donné confiance en moi. Alors que j’étais très jeune, que je venais du Bronx, il m’ont traité comme une personne, pas comme un délinquant ou un vandale. J’étais curieux de tout, je voulais tout comprendre : la musique, l’art… Ils m’ont appris les codes du monde de l’art, moi qui ne connaissais que les codes de la rue. J’étais encore un peu sauvage, ne sachant même pas tenir une fourchette ! Un jour, invité dans un immeuble de la 5e Avenue [le quartier le plus chic de Manhattan, NDLR], je suis monté par l’escalier comme je le faisais dans ma cité et j’ai tagué les murs blancs avec le marqueur que j’avais dans ma poche [rires]. Un moyen de montrer que j’étais là. Et j’ai appris, petit à petit.
Joues-tu le même rôle avec les jeunes artistes ?
Jean-Michel m’a dit un jour : « Ce que j’ai fait pour toi, tu dois le faire pour quelqu’un d’autre ». Cette sagesse qui lui et les anciens, comme Dondi ou Rammellzee, m’ont apporté, je me devais de l’offrir aux autres, et c’est ce que je fais, depuis plus de 30 ans pour beaucoup de petits frères, peintres, tatoueurs, musiciens… Lorsque je le peux, je le fais avec un grand plaisir… C’est ainsi que j’honore la demande de mon pote Jean-Michel.




Je questionne le système parce que je n’accepte pas d’être soumis.
tOXIC
Tu étais très proche de A-One et Rammellzee. Comment ont-ils influencé ton travail ?
Nous étions comme des frères et peignions en équipe. Nous avons travaillé ensemble sur les couleurs, la technique… Nous étions presque interchangeables. Je suis sûr qu’A-One pouvait faire du Toxic ! Il faut dire que peindre des trains ne se faisait pas toujours dans les meilleures conditions [rires]. Et quand l’un commençait un wagon, l’autre le finissait souvent.
Pourquoi avoir quitté les États-Unis pour l’Italie puis la France ?
D’abord, parce que j’en ai eu la possibilité. Salvatore Ala m’a proposé une exposition à Milan. Et j’ai participé à Arte di Frontiera : New York Graffiti in Italy à Bologne avec A-One, Basquiat, Crash, Futura 2000, Keith Haring… grâce à Francesca Alinovi. Les collectionneurs Italiens se sont intéressés aux pionniers New-Yorkais bien avant le « buzz » Parisien ! Ensuite parce que, au début des années 1980, les États-Unis c’était le racisme, le sida, le crack… Je me suis dit : « Si tu restes ici, tu vas crever ou finir en prison ». L’Europe, pour un métis du Bronx de 20 ans, était la découverte d’un autre monde : la Heineken en bouteille et les bretzels en Allemagne, la vraie pizza en Italie… Pour moi, c’était Disney World [rires].
Tu n’aimes pas être vu comme un street artiste…
Je me sens super insulté quand on me dit que je suis un graffeur ! J’ai commencé dans la rue, mon atelier n’était ni un bel endroit avec quatre murs, ni la grange de la ferme de ma grand-mère mais un parking au sous-sol de ma cité de 20 étages. Alors, certes, j’ai un parcours différent mais mon travail a-t-il moins de valeur pour autant ? Si j’étais blanc et issu d’une famille bourgeoise, on me considérerait comme un artiste contemporain, ce que je suis d’ailleurs, pas comme un street artiste, même si j’avais commencé par le graffiti ! Je viens du Bronx et pourtant mes œuvres sont accrochées dans les musées depuis 40 ans.
Pourtant, la bombe est toujours ton média préféré ?
J’ai eu le privilège de voir travailler ceux qui étaient là avant moi, comme Dondi, Futura…, avec une bombe et d’apprendre la technique. Tout ce que je sais de la bombe vient d’eux. La bombe est mon premier amour. Comme la première fille que tu as embrassé, tu ne peux pas l’oublier. Lorsque j’utilise une autre technique, j’ai parfois le sentiment de trahir la bombe, comme si j’allais avec une autre femme. Mais bombe, huile, acrylique, pastels… je cherche avant tout ce qui donnera le meilleur résultat… pour moi et non pour les autres. Parce que si je n’aime pas ce que j’ai fait, je ne le montre à personne. En ce moment, je recherche plutôt la texture, la profondeur. Et la bombe est plate, unidimensionnelle…
Avec Jean-Michel Basquiat et Rammelzee, tu as formé le groupe des Hollywood Africans. Aujourd’hui, as-tu toujours un message à faire passer ?
Je ne souhaite pas faire passer un message politique… ; ma vie parle pour moi. En revanche, je questionne le système parce que je n’accepte pas d’être soumis. Je suis noir, né dans une cité du Bronx d’une mère portoricaine et d’un père trinidadien immigré. Et aujourd’hui, à 57 ans et toujours vivant, je suis un homme de couleur qui a du succès, un artiste dont les œuvres sont dans les musées du monde entier, une personne cultivée qui parle quatre langues, créative et pas stupide. Je ne suis pas Kanye West [rires].
Quel regard portes-tu sur la nouvelle génération qui, elle, se réclame du Street Art ?
Je suis content pour eux que les galeries se soient ouvertes. Lorsqu’A-One était à Paris, c’est agnès b. qui l’a sauvé. On ne témoigne pas assez de reconnaissance envers cette femme, l’une des plus grandes collectionneuses d’art et de graffiti. Jamais je n’aurais imaginé gagner ma vie avec l’art. Mais dès que nous avons compris que nous étions des artistes, notre devise fut : Don’t go Van Gogh. Pas question de crever comme Van Gogh, sans argent et avec une oreille en moins ! Telle était la motivation, pour moi et pour beaucoup de mes amis. Mais il est amusant de constater que, désormais, on peut étudier le Street Art dans les écoles d’art. Nous, nous ne sommes pas allés à l’université pour devenir des artistes urbains, nous étions dans la rue, c’était notre vie.
As-tu l’impression que l’histoire est parfois réécrite ?
En tout cas, il n’y a aucune mémoire ! Je ne suis pas englué dans les années 1980 mais je constate hélas que peu connaissent l’histoire et ne s’y intéressent même pas. Beaucoup font aujourd’hui ce j’ai déjà fait mais lorsqu’on leur demande s’ils savent qui je suis, ils répondent : « Toxic, je ne connais pas ». Il serait bon de leur rappeler que, quand nous avons commencé, ils étaient encore en couches-culottes. La réalité c’est que nous ne faisons simplement pas la même chose. Mon travail est de créer et non de juger les autres… Keith Richards n’a jamais caché qu’il puisait son inspiration des mecs jouant dans les années 50 dans l’état du Mississippi ! Cette humilité, cette humanité manque cruellement au monde du graffiti et beaucoup de choses fausses circulent. Et alors que les Français aiment les bibliothèques et les faits historiques, l’histoire de ce mouvement « sauvage » ne les intéresse pas.
La reconnaissance vient-elle du marché ?
Oui, mais ce qui se passe sur le second marché m’intéresse assez peu. Les prix n’ont aucun rapport avec la valeur de l’artiste. Quand il était vivant, Jean-Michel vendait ses toiles entre entre 15.000 et 20.000 euros. Aujourd’hui, c’est entre 15 et 20 millions. Vingt-sept ans après sa mort, on reconnaît son génie ; moi, je l’ai su dès le début. Seul le premier marché m’intéresse. Mes pièces vont de mon atelier aux galeries et des galeries aux collectionneurs. Et que quelqu’un achète une de mes œuvres parce qu’il aime mon travail, connaît mon histoire et non parce qu’il va la revendre aux enchères six mois plus tard reste le plus beau compliment qu’il puisse me faire. Quand je vois certains artistes actuels qui vendent dix fois plus cher que moi, sans parcours, sans être dans les collections et les musées… je me dis : « Kanye West existe » !
Basquiat, Wharol et les artistes d’East Village m’ont traité comme une personne, pas comme un délinquant, et m’ont appris les codes du monde de l’art, moi qui ne connaissais que les codes de la rue.
tOXIC
Comment réagis-tu quand on dit que tu es une légende vivante ?
Je n’aime pas ! Les légendes sont mortes. Une légende vivante, c’est un oxymore. Une bonne légende, c’est une histoire dépassée, une histoire du passé.
Et toi, tu es bien actuel…
Oui. Je suis même « monsieur demain » [rires] !
Tu es aussi un artiste pluridisciplinaire…
Oui. La musique est mon premier amour, avant le graffiti. J’ai fait de la break dance, j’ai été DJ… Et la photographie a toujours fait partie de ma vie, depuis mes 17 ans jusqu’à aujourd’hui. Andy Wharol avait toujours un appareil avec lui, pour garder une trace de ce qu’il faisait, du lieu où il se trouvait, des gens qu’il rencontrait. Et je fais la même chose où que je sois dans le monde. Je photographie ce que je vois, ce qui attire mon attention et qui nourrit mon art. Je ne suis pas quelqu’un de nostalgique mais, de temps en temps, je regarde une photo et je me souviens des personnes, de nos conversations, de ce que l’on a réalisé ensemble. Un jour, j’aimerais d’ailleurs proposer une exposition, peut-être en Italie, de ces photos que je prends depuis 40 ans. Il me semble que c’est important pour l’histoire…